Le travail social en voie d’industrialisation ?
Sociologie et Anthropologie Travail social
25 Déc 2018
Imprimer
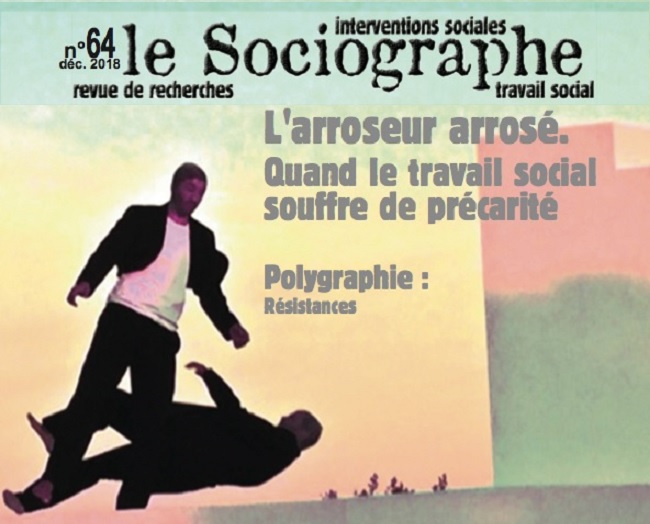
Jonathan Louli, 2018, « Le travail social en voie d’industrialisation ? », in Le Sociographe, n°64, pp. 95-103
Article prochainement disponible sur Cairn
Voir le site de la revue Le Sociographe
Voir l’introduction du numéro de la revue ici en PDF
Résumé de l’article :
À partir de mes expériences de recherche, de travailleur social et de militant, je développe l’idée que pour mieux faire des bénéfices sur le travail social, l’État et les «entrepreneurs sociaux» doivent d’abord le transformer en une grande usine facile à gérer, et les travailleuses et travailleurs sociaux en ouvrières et ouvriers. Pourtant ces réflexions peuvent nous rappeler qu’à ce jeu, l’État a toujours eu du fil à retordre de la part de ce qu’on appelait le «mouvement ouvrier», et qu’on appelle désormais plutôt le «mouvement social».
Quel que soit le point de vue adopté sur l’univers du travail social, on est généralement amené à considérer que ce dernier ne va pas très bien. Diminution de financements, tensions dans la commande politique, dégradation des conditions de travail, montée des inégalités, pertes de sens… Les motifs d’inquiétude sont très nombreux et complexes, et c’est peut-être cela le principal motif d’inquiétude ! Il est nécessaire de faire un pas de côté et de prendre le temps de l’analyse pour y voir plus clair.
Cet article est issu de réflexions, d’observations de terrain et d’expériences professionnelles et militantes que j’ai depuis plusieurs années dans le travail social, en tant que chercheur, formateur, animateur dans le handicap, éducateur en prévention spécialisée, travailleur social en insertion par le logement, mais aussi comme militant dans différentes sphères. Ces multiples recherches, rencontres et expériences m’ont fait découvrir et éprouver de nombreuses remises en cause du sens de l’intervention des travailleuses et travailleurs sociaux. À celles et ceux qui cherchent à comprendre la situation globale dans laquelle se trouvent les secteurs sociaux, je propose une grille de lecture qui peut par ailleurs suggérer des pistes d’action.
Cette grille s’appuie sur le constat que, après avoir « privatisé » ou « libéralisé » des secteurs d’activité de plus en plus nombreux, les détenteurs des pouvoirs économiques et politiques préparent maintenant l’entrée des logiques marchandes dans le social. Cette entrée fracassante du capitalisme dans nos secteurs a pour prix un processus d’industrialisation ; c’est-à-dire qu’à mon sens, les métiers du social tendent à être considérés et gérés comme du travail d’usine. Jusqu’à présent, j’ai observé cette industrialisation principalement à travers trois phénomènes concrets : une marchandisation des cadres d’intervention, une standardisation des pratiques professionnelles et une prolétarisation des travailleuses et travailleurs sociaux. Ce sont des processus en cours qui se présentent sous différentes formes selon les départements, les services, les équipes et les moments, mais qui globalement ne font qu’enfler.
Mon article visera à présenter plus clairement ce que signifient tous ces gros mots : standardisation, marchandisation, prolétarisation, industrialisation. Mais si je peux me permettre de résumer, mon idée est que, pour mieux faire des bénéfices sur le travail social, l’État et les « entrepreneurs sociaux » doivent d’abord le transformer en une grande usine facile à gérer, et les travailleuses et travailleurs sociaux en ouvrières et ouvriers. Pourtant ces réflexions peuvent nous rappeler qu’à ce jeu, l’État a toujours eu du fil à retordre de la part de ce qu’on appelait le « mouvement ouvrier » et qu’on appelle désormais plutôt le « mouvement social ». Je développerai ce point en conclusion.
La marchandisation des secteurs
C’est généralement un constat partagé, comme dans le cas des services publics : les logiques marchandes s’étendent sans cesse. L’aide aux devoirs, les établissements pour personnes âgées dépendantes, les services à la personne, les agences de voyages « adaptées », la petite enfance… De nombreux secteurs du social au sens large sont déjà en grande partie ouverts aux acteurs marchands et à la concurrence. Pourtant, non seulement il n’est pas prouvé que l’ouverture à la concurrence soit plus pertinente que le service public ou l’associatif, mais surtout, cela revient à faire primer les intérêts de l’économie et du marché sur les intérêts de la société et des gens. Cependant à l’heure actuelle cette marchandisation des secteurs sociaux se manifeste surtout à travers les façons de le financer.
En effet, les acteurs associatifs, voire publics, sont mis en concurrence les uns avec les autres à travers les appels à projets qui concèdent des fonds pour de courtes périodes. Les financements généreux et pérennes sont en raréfaction : les politiques d’austérité cherchent à rentabiliser les investissements comme si l’État était un actionnaire : pas assez de profits électoraux ou financiers ? On supprime ! Peu importe l’intérêt que les citoyens y trouvaient : hôpitaux, écoles, associations, administrations, aides sociales… tout y passe, sauf peut-être les salaires des élus et les grandes fortunes. Dans le travail social, concrètement, c’est la prévention spécialisée qui a été ravagée quasiment partout par les coupes budgétaires de façon paradoxale, et cela je l’ai vécu sur le terrain quand j’étais éducateur de rue. Le secteur social est de plus en plus exposé aux plans de licenciements collectifs, comme dans le secteur industriel, à cause des logiques marchandes et des politiques d’austérité. La protection de l’enfance en est le triste exemple, dans différents départements, notamment le Maine-et-Loire ces derniers mois.
Ce n’est pas tout : depuis le passage d’Emmanuel Macron au Ministère de l’Economie, des investisseurs privés peuvent prendre part aux financements d’actions sociales via les Contrats à impact social (Alix, Autès & Garrigue, 2018). En gros, ces investisseurs choisissent, selon leurs propres critères, dans quelle cause ils veulent placer leur argent, l’État les rembourse dans le temps et leur verse même des intérêts à terme si l’action subventionnée présente des évaluations satisfaisantes. Évaluations de qui ? De quoi ? Comment ? Laissez ! L’État et ses experts (agréés par l’État) s’en occupent.
Ces différentes logiques en développement privilégient le plus rentable en termes de pouvoir économique ou politique. Cette quête de bénéfices nécessite des instruments pour gérer le travail et prévoir les bilans comptables. On observe alors le développement de modes de gestion « par la qualité », largement inspirées des secteurs marchands. Ils visent à faire adhérer les travailleuses et travailleurs à une « discipline par le produit » (Infoaut Turin, 2017), c’est-à-dire à une standardisation de leur activité dictée par des exigences de « qualité » mesurables.
La standardisation des pratiques professionnelles
Les « référentiels » (Chauvière, 2006), les appels à projets et leurs cahiers des charges, les tableaux de bord, les bilans d’activité, les fiches de liaison ou de suivi, les diapositives PowerPoint, le mille-feuille de règlementations et de projets institutionnels…, tous ces documents et ces dispositifs — et surtout les façons dont ils sont utilisés —, marquent le développement de logiques industrielles et marchandes. Ce sont les outils de gestion dont disposent l’État et le marché, leur principale technologie. Se multiplient et s’empilent alors les procédures de travail et d’évaluation formatées, imposées d’en haut aux travailleuses et travailleurs ; avec pour objectifs de faire entrer le réel dans les cases de tableaux de reporting, de notes de service et de bilans financiers, malgré toute la complexité, la diversité, l’imprévisibilité de ce réel, en un mot son « indétermination » (Castoriadis, 1975).
Cela a pour conséquence qu’un nombre croissant de travailleuses et travailleurs de terrain dans le social n’arrivent plus à analyser et à rendre compte correctement de leur travail : celui-ci perd de son sens au fur et à mesure qu’il est défini et standardisé par ceux qui imposent les outils pour le gérer et l’évaluer (Dejours, 2003). Dans plusieurs services où j’ai travaillé, les Groupes d’analyse des pratiques (GAP) par exemple, n’étaient plus qu’un lieu de plainte et de critique de l’institution et de la hiérarchie. Une soupape qui permettait par ailleurs de neutraliser la conflictualité.
Cette standardisation du travail s’observe également, dans une certaine mesure, à travers les réformes récentes des formations en travail social et spécifiquement la dernière « refonte » qui doit entrer en vigueur en septembre 2018. Comme l’ont montré les réflexions et les actions du collectif Avenir’Educ, il se profile à terme des formations reformatées et appauvries, laissant moins de place aux sciences humaines et aux savoir-faire historiques des professions ; des formations qui tendront à inculquer à tous les mêmes savoirs, les mêmes méthodes, les mêmes façons de traiter les problèmes, bref : des formations qui préparent au travail à la chaîne. Ces dispositifs de standardisation des pratiques professionnelles sont des outils, des technologies de l’État et du marché pour domestiquer le travail de terrain : « La technologie capitaliste a une mission politique d’organisation sociale : incorporer le plus possible de travail vivant dans la machine, contrôler, codifier et discipliner ce qui reste de travail vivant ouvrier afin de maximiser la valorisation, la production et donc le profit. La technologie est donc, avant tout, codification du comportement ouvrier » (Infoaut Turin, 2017).
Pour les détenteurs de pouvoirs, la pratique professionnelle doit donc idéalement devenir aussi standard qu’une chaîne de montage, pour qu’elle soit facile à anticiper et à gérer. De cette façon, les calculs coûts/bénéfices de chaque élément sont moins soumis aux aléas du « facteur humain ». Standardisation et marchandisation visent à optimiser la maîtrise économique et politique. Comme à l’usine, cette maîtrise du travail atteint spécifiquement les travailleuses et les travailleurs sociaux eux-mêmes, ainsi que les publics. Les professionnels de terrain voient leurs conditions de vie, de travail, de reconnaissance, se dégrader. C’est la troisième dimension du processus d’industrialisation que je souhaitais aborder : la prolétarisation des travailleurs et travailleuses sociaux.
La prolétarisation des professionnels de terrain
Être un prolétaire, au sens moderne, signifie avant tout : n’avoir que ses bras ou son cerveau pour vivre et devoir par conséquent se salarier (par opposition, ce qu’on appelle traditionnellement les « bourgeois » sont ceux qui ont justement les moyens de faire travailler des prolétaires à leur service). Techniquement, les travailleuses et travailleurs sociaux sont donc déjà des prolétaires. Celles et ceux d’entre eux qui ont une femme de ménage et une nourrice s’approchent à la limite de la « petite bourgeoisie », comme on dit parfois. Mais globalement les travailleuses et travailleurs sociaux sont plus proches des mondes ouvriers que des milieux aisés.
Pourtant, pour différentes raisons, le travail social n’a pas eu une place très marquée dans le « mouvement ouvrier ». Le sujet mérite d’être creusé, car vu de l’extérieur, l’industrialisation de nos secteurs nous soumet de plus en plus à la concurrence et à la performance, à l’exploitation et à la perte de sens : les travailleuses et travailleurs sociaux sont amenés à devenir des ouvriers de la relation. L’exploitation se voit aisément, ne serait-ce que par rapport aux niveaux de salaire. De nombreux professionnels touchent un salaire inférieur au salaire médian français, c’est-à-dire qu’ils font partie des 50 % de la population du pays qui touche moins de 1800 € net mensuellement. En général, les travailleurs sociaux touchent moins que le salaire mensuel moyen français qui est de 2200 € net. Sous ce point de vue, le travail social ressemble de plus en plus à un espace où des pauvres essaient d’aider des très pauvres à s’en sortir. L’exploitation commence même avant que les travailleuses et travailleurs soient diplômés : les étudiants ont les plus grandes difficultés à trouver de bonnes conditions de stages et sont payés une misère (3,6 € de l’heure), tout comme les professionnels en apprentissage qui peuvent être payés moins que le SMIC. J’ai souvent observé, dans mon réseau personnel, des collègues en formation qui avaient des situations bien plus précaires ou difficiles que les personnes qu’ils ou elles étaient censées accompagner.
Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que les travailleurs sociaux sont dans une écrasante majorité des travailleuses sociales, ce qui implique d’autres inégalités en milieu professionnel. Comme l’ont établi les théories du care, les femmes sont plus incitées à exercer un métier où elles prennent soin d’autrui, on attend alors d’elles une forte implication psychique que l’on peine à reconnaître à sa juste valeur : « il est difficile de savoir si les métiers du social sont peu valorisés parce qu’ils sont féminins, ou s’ils sont féminins parce qu’ils sont peu valorisés. Mais ce qui est clair, c’est que l’un renforce l’autre » (Daovannary, 2011).
Dans cette logique vient s’ajouter l’activisme du syndicat patronal Nexem qui aimerait niveler par le bas les Conventions collectives (c’est-à-dire les règlementations sur les droits des travailleurs et des travailleuses : contrat de travail, salaires, congés, conditions de travail…). C’est la même logique que n’importe quel lobby patronal : défendre les intérêts des employeurs, réputés être les acteurs les plus clairvoyants.
Ces indices de l’exploitation s’ajoutent aux développements de la marchandisation, de la concurrence, des technologies de standardisation des pratiques, à l’instrumentalisation du travail à des fins politiques ou économiques… L’addition de ces éléments, que chacun d’entre nous vit en partie, provoque une perte du sens de l’engagement dans le travail social. Ce que signifie « travailler dans le social », en subissant une industrialisation, ne correspond plus à l’idée qu’en ont en général les gens qui s’y engagent. Le sens de leur travail leur est ôté, il est transformé, nié ou mal reconnu. On peut appeler « aliénation » cette perte de sens du travail que subit l’ouvrier jusqu’à voir parfois son bien-être et sa santé en pâtir (cf. Fischbach, 2006 et Dejours, 2006).
Conclusion
On peut considérer que pour entrer en résistance, il faut d’abord une prise de conscience. C’est d’autant plus vrai que le travail social est fondé sur le sens des actions réalisées. Il faut redonner du sens au travail social, non pas en espérant trouver une hypothétique vérité absolue du travail social, mais en lui construisant un sens nouveau à la lumière de l’industrialisation qu’il subit. Dans cette perspective il n’y a pas simplement à prendre conscience des difficultés des secteurs, il faut également comprendre la fonction des détenteurs de pouvoirs économiques et politiques dans ces difficultés et comprendre nos propres capacités collectives.
En effet, on voit des acteurs politiques de premier plan, des hauts fonctionnaires et autres agents de l’État largement de collusion avec des lobbies financiers et patronaux, se rejoindre dans une vision : il faut privatiser, rendre rentable, mais pour cela, contrôler la « qualité » et les procédures de travail. La plupart du temps, cette vision s’applique sans consulter les acteurs de terrain et encore moins les personnes accompagnées. C’est même souvent une vision qui est opposée aux intérêts directs des travailleurs de terrain et des personnes accompagnées.
Les détenteurs de pouvoir défendent leurs intérêts en étant convaincus que cela peut éventuellement être bon pour l’intérêt général : c’est la théorie du « ruissellement » ou des « premiers de cordée » dont nous parlent les libéraux. Avec le social, ils ne jouent plus le jeu de l’éthique et de la morale, mais du patron et de l’ouvrier. Ils nous demandent de guetter les dettes locatives, les consommations d’alcool, les fraudes aux aides sociales, le manque de « mobilisation », ou encore de participer à l’expulsion de « sans-papiers » !
La conduite des détenteurs de pouvoirs vis-à-vis du travail social actualise ce qu’on appelle les « luttes de classes ». Cela signifie que dans le capitalisme, les détenteurs de pouvoirs économiques et politiques, plus conscients de leurs intérêts collectifs et plus mobilisés, défendent leurs privilèges y compris contre les autres classes ou groupes sociaux. Au gré de ces rapports de force entre groupes sociaux, les logiques marchandes et industrielles qui caractérisent le capitalisme évoluent : certains secteurs de la société s’en libèrent progressivement, d’autres s’y retrouvent prisonniers. Les secteurs sociaux, constitués par des approches artisanales et cliniques, sont désormais rongés par l’industrialisation et la marchandisation, les travailleuses et travailleurs sociaux sont appelés à devenir des ouvriers de la relation. Soit !
Il faut prendre acte de ce fait et prendre du recul sur la place du travail social dans la société pour retrouver des marges de réflexion et d’action. Il faut se demander si l’on est au service des gens ou au service de nos patrons : l’État et la croissance économique ? Celles et ceux qui refusent d’opter pour la seconde option, sont généralement amenés à se questionner sur leur place et celle de leur travail dans le « mouvement ouvrier », ou « mouvement social ». Je n’ai, bien entendu, pas de recette magique, mais une chose est sûre, c’est qu’il faut faire du collectif.
Tous ensemble, nous savons ce qu’est l’intérêt général, tous ensemble, sur le terrain, nous savons ce qu’implique le travail, nous partageons des conditions communes. Faire du collectif au sein de nos établissements et en dehors, y compris avec les personnes accompagnées dont nous sommes plus proches que nous le pensons. Faire du collectif dans un cadre militant ou amical, autour de ce que nous avons en commun : le fait de vouloir donner du sens à notre travail. Tel me semble être une base importante pour penser des pistes d’action, des solutions. Et à terme, renverser le rapport de force et susciter le changement.
Bibliographie :
Alix, Jean-Sébastien ; Autès, Michel ; Coutinet, Nathalie et Garrigue, Gabrielle, « Les contrats à impact social : une menace pour la solidarité ? », in La Vie des idées, Institut du monde contemporain (Collège de France), dirigé par Pierre Rosenvallon, 16 janvier 2018. En ligne : http://www.laviedesidees.fr/Les-contrats-a-impact-social-une-menace-pour-la-solidarite.html (consulté le 3/09/2018).
Castoriadis, Cornélius, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975.
Chauvière, Michel. « Les référentiels, vague, vogue et galères », in Vie sociale, n° 2, vol. 2, 2006, pp. 21-32.
Daovannary, Linda, « Métiers du social : quand féminisation rime avec moindre valorisation », in TSA Quotidien, n° 24, Le travail social serait-il une affaire de femme ?, juillet 2011. En ligne : http://www.tsa-quotidien.fr/content/metiers-du-social-quand-feminisation-rime-avec-moindre-valorisation (consulté le 3/09/2018).
Dejours, Christophe, L’Évaluation du travail à l’épreuve du réel : Critique des fondements de l’évaluation, Paris, INRA Éditions, 2003.
Dejours, Christophe, « Aliénation et clinique du travail », in Actuel Marx, n° 39, Nouvelles aliénations, Paris, PUF, 2006/1, pp. 123-144.
Fischbach, Franck, « Activité, Passivité, Aliénation », in Actuel Marx, n° 39, Nouvelles aliénations, Paris, PUF, 2006/1, pp. 13-27.
Infoaut, Turin, « Quelle condition ouvrière aujourd’hui », in Revue Période, le 16 octobre 2017. En ligne : http://revueperiode.net/quelle-condition-ouvriere-aujourdhui/ (consulté le 3/09/2018).
