« De la dangerosité au risque », selon Robert Castel : leçon sur la gestion de crise sanitaire…
Psy, soins, santé Sociologie et Anthropologie Travail social
19 Jan 2022
Imprimer
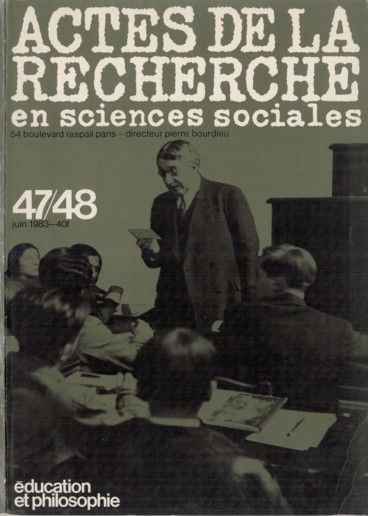
Jonathan Louli, 2020, « « De la dangerosité au risque », selon Robert Castel : leçon sur la gestion de crise sanitaire… », in : site jlouli.fr
Note de lecture de :
Robert Castel, 1983, « De la dangerosité au risque », in Actes de la recherche en sciences sociales, n°47-48, pp.119-127, en ligne : https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1983_num_47_1_2192
La crise du coronavirus a braqué les projecteurs sur la situation critique dans laquelle se trouvent les secteurs du social et de la santé. De nombreuses analyses de cette crise pointent ainsi la responsabilité des politiques publiques de marchandisation et de gestionnarisation qui se développent au moins depuis les années 1980, lorsque l’appareil d’État a commencé à se convertir à la course à la rentabilité, aux nouvelles logiques technocratiques et sécuritaires[2]. Le sociologue Robert Castel (1933-2013) a été parmi les premiers à pressentir comme cette séquence des années 1980 était une période charnière, à l’articulation entre différents modèles d’intervention de l’appareil d’État.
En effet, avant de s’intéresser à la « question sociale » et au salariat, Castel avait commencé par travailler sur les champs de la psychanalyse et de la santé mentale, très influencé par les idées de Michel Foucault. Entre différents livres et articles publiés dès les années 1970, c’est notamment l’article « De la dangerosité au risque » sorti en 1983 dans la revue fondée par Pierre Bourdieu, Actes de la recherche en sciences sociales, qui permet le mieux de se faire une idée de la façon dont cette évolution des politiques sanitaires et sociales est abordée par le fameux sociologue, qui en a été parfaitement contemporain, et qui structure encore très largement notre séquence actuelle.
Dans cet article, Castel affirme que nous assistons depuis les années 1960 à une technicisation croissante des activités de soin et d’accompagnement social, ce qui engendre une mise en « crise de la clinique », c’est-à-dire une « crise de la relation personnalisée entre un professionnel et son client », au profit d’une logique de gestion des risques dominée par des dispositions technocratiques. Le sociologue va alors chercher à étudier les implications théoriques et pratiques de ces évolutions dans les domaines sociaux et sanitaires, et comment ces reconfigurations se présentent dans ces champs professionnels. En synthétisant son propos, je montrerai les échos que cette analyse peut avoir dans l’actualité.
1. Prévenir les dangers ou prévenir les risques ?
Il est important d’étudier les « stratégies préventives » qui se développent durant cette séquence de transition des années 1980, car elles sont relativement novatrices par rapport aux formes anciennes des métiers du travail social et de la santé mentale. La thèse de Castel (p. 119) est en effet que « ces nouvelles stratégies passent par la dissolution de la notion de sujet ou d’individu concret, qu’elles remplacent par une combinatoire construite de facteurs, les facteurs de risque », ce qui a pour conséquence que « le moment essentiel de l’intervention cesse d’être une relation directe (…) Il est dans la construction de flux de population à partir de l’assemblage de facteurs abstraits qui sont susceptibles de produire du risque en général ». Avec cette reconfiguration de la logique de construction de l’intervention, s’ensuit nécessairement « un déséquilibre entre le point de vue des techniciens d’une part, et celui des administrateurs qui définissent et mettent en œuvre ces politiques sanitaires d’autre part. Les premiers se trouvent subordonnés aux seconds, et une politique gestionnaire peut s’autonomiser complètement, échapper totalement au contrôle des opérateurs de terrain qui deviennent de simples exécutants ». La relation avec la personne tend à être supplantée par « l’examen de ses dossiers, tels qu’ils ont été établis dans des situations diverses par des professionnels différents (les différents spécialistes) qui n’ont aucun rapport entre eux, si ce n’est par l’intermédiaire de la circulation des dossiers » et des « différentes expertises » qui les constituent, entraînant ainsi le passage « du regard au stockage objectif de données ». Avant d’étudier les conséquences sociologiques de ces évolutions dans le travail social et de santé mentale, Castel opère un retour sur les conditions sociohistoriques qui les ont faites émerger.
Il rappelle que la dangerosité en psychiatrie était une notion ambiguë qui ne pouvait s’appuyer que sur des « imputations », en l’absence d’un passage à l’acte. Difficile donc de fonder une véritable « politique préventive », si ce n’est sur « l’enfermement et la stérilisation », dont on s’est vite aperçu qu’ils n’étaient pas des solutions satisfaisantes.
Dès le milieu du XIXème, certains tels que le psychiatre français Morel, vont alors chercher à séparer la dangerosité potentielle et son sujet, et raisonner à partir de la « fréquence des anomalies » parmi des couches spécifiques de la population les plus touchées : les prolétariats et sous-prolétariats. Le but était de dégager des « risques objectifs, c’est-à-dire des corrélations statistiques entre des séries de phénomènes » (p. 120). De ces évolutions s’inspire l’eugénisme qui se traduit dans des politiques publiques dès le début du XXème siècle : « le but d’une intervention conduite au nom de la préservation de la race est beaucoup moins de traiter un individu particulier que d’empêcher que la menace qu’il porte soit transmise à sa descendance » (p. 121). Les plus connues des politiques eugénistes sont les pratiques de stérilisations qui se répandent alors aux États-Unis, mais la France connaît également le développement de théoriciens et de dispositifs eugénistes, avant que ce courant de pensée, l’un des inspirateurs du nazisme, ne soit progressivement abandonné.
Aux États-Unis, les politiques de prévention font alors de plus en plus appel à partir des années 1960 à des professionnels de la psychiatrie pour conseiller les décideurs sur la gestion des « anomalies » psychosociales. Le président R. Nixon cherche à faire dépister, pour ainsi dire, les enfants potentiellement violents, potentiellement déviants, pour mettre en place des « traitements correctifs » pouvant aller jusqu’à « l’enrôlement de force dans des camps spéciaux » (p. 122). En France, à la même époque, bien qu’influencée par la psychiatrie infantile, la prévention de la déviance juvénile prend une forme bien différente, moins sécuritaire et sanitaire, et sera nommée « prévention spécialisée ».
Bien que cette forme de prévention des risques soit inscrite dans les référentiels de l’éducation spécialisée, de l’action socioéducative, voire de l’éducation populaire selon les équipes, son institutionnalisation à partir des années 1960 la confronte aux cadres généraux des politiques sociales, desquels émergeront les logiques technocratiques de gestion des risques, comme le fait remarquer une sociologue proche de P. Bourdieu et R. Castel, qui écrit à la même époque que ce dernier : « Chaque fois qu’ils s’opposent à leurs employeurs, à la justice ou à la police, les éducateurs de prévention oublient qu’ils leur accordent, implicitement, quelques points fondamentaux : d’abord la reconnaissance que certains milieux, en raison de leurs caractéristiques objectives (sociales et raciales), nécessitent une intervention particulière. Ensuite, à la base de leur action, une représentation de la délinquance qui diffère peu de la conception dominante »[3]. C’est en effet ce que fait observer R. Castel lui-même : « pour être suspect, il n’y a plus besoin de manifester des symptômes de dangerosité ou d’anomalie, il suffit de présenter quelques particularités que les spécialistes responsables de la définition d’une politique préventive ont constituées en facteurs de risques » (p.123).
2. Si le risque est partout, la gestion du risque doit l’être aussi
Les limites à l’extension du pouvoir sanitaire et notamment psychiatrique sont levées lorsqu’est rompu le primat de la « relation directe au sujet assisté » qui caractérisait les formes classiques du travail social, de l’assistance et de la santé mentale, au profit d’une notion de risque rendue autonome par rapport à celle de danger : « un risque ne résulte pas de la présence d’un danger précis, porté par un individu ou même un groupe concret. Il est effet de la mise en relation de données abstraites ou facteurs qui rendent plus ou moins probable l’avènement de comportements indésirables ». Ainsi, « on dissocie franchement le rôle technique du praticien et le rôle gestionnaire de l’administrateur » (p. 122).
Ces observations ont un triste écho dans l’actualité : nous semblons tant être habitués à être déresponsabilisés et privés de tout pouvoir de décision importante par les administrateurs et les experts, par leurs impératifs gestionnaires, que nous en sommes réduits, en cas de crise sociale, psychique ou sanitaire, à ne pouvoir que déplorer leurs défaillances et en appeler au renforcement des mesures de surveillance et de contrôles : « Ces politiques préventives promeuvent ainsi une nouvelle modalité de la surveillance : le dépistage systématique. Il y a surveillance en ce sens que le but visé est d’anticiper et d’empêcher l’émergence d’un événement indésirable, maladie, anomalie, comportement déviant. Mais cette surveillance économise la présence réelle, le contact, la relation réciproque entre le surveillant et le surveillé, le gardant et le gardé, le soignant et le soigné ». Alors que la « coprésence », ou à la limite le « regard », étaient « une exigence de toutes les techniques disciplinaires, assistancielles ou thérapeutiques classiques » (p. 123), nous nous habituons à n’être plus soignés ou accompagnés, ou plus seulement, mais aussi et surtout surveillés, contrôlés, et enjoints à prendre part à la gestion des risques qui cernent notre existence.
Nous nous habituons à être seuls, face à des dispositifs de dépistage, de contrôle voire d’autocontrôle, qui peuvent remplacer la présence de professionnel.le.s attentifs, et qui, tout du moins, participent de la dématérialisation des services publics et non-marchands, et surtout, de la surveillance généralisée : « désormais, la surveillance peut s’exercer en dehors de tout contact et même de toute représentation directe des sujets à surveiller. Sans doute la police constituait-elle depuis longtemps des fiches secrètes. Mais la logique de l’élaboration des dossiers souterrains est devenue la forme sophistiquée, et fière de l’être, du dépistage « scientifique ». Il y a là, me semble-t-il, une véritable mutation, qui peut donner une extension extraordinaire aux nouvelles technologies de surveillance » (p. 123). Que le regard porte sur l’hôpital, la psychiatrie, le travail social ou les institutions sociales, on ne peut que donner raison à Castel : les impératifs de gestion administrative et comptable, de gestion des risques sécuritaires et « risques d’inadaptation » y sont devenus surdéterminants, s’appuyant sur des fichiers généraux et bases de données, des tableaux de bord, logiciels de reporting, et autres « fiches de suivi »…
Même si l’idéologie libérale moderne proclame avec acharnement le « droit des usagers » depuis une vingtaine d’années au moins, il faut cependant bien voir comme, dans les faits, l’obligation de respecter ce droit s’adresse en priorité aux professionnel.le.s de terrain, tandis qu’en réalité, l’image et l’identité des personnes qui doivent bénéficier de ces services sont disloquées derrière leurs « dossiers », ceux-ci étant fondés sur de multiples « expertises », « diagnostics » et facteurs de risque constitutifs des indicateurs de gestion sur lesquels s’appuient les politiques publiques : « En fait, il n’y a pas de rapport d’immédiateté à l’égard d’un sujet parce qu’il n’y a plus de sujet. Ce dont ces politiques préventives traitent d’abord, ce ne sont plus des individus, mais des facteurs, des corrélations statistiques d’éléments hétérogènes. Elles déconstruisent le sujet concret de l’intervention et reconstruisent une combinatoire de tous les facteurs susceptibles de produire du risque. Leur visée première n’est pas d’affronter une situation concrète dangereuse, mais d’anticiper toutes les figures possibles d’irruption du danger. « Prévention » en effet, qui élève le soupçon à la dignité scientifique d’un calcul de probabilités ». Il s’agit de « construire les conditions objectives d’apparition du danger pour en déduire de nouvelles modalités d’intervention » (p. 123).
La « généralisation abstractivante », c’est-à-dire la multiplication de facteurs de risque abstraits, dans l’idée de tout subordonner aux nécessités de leur gestion, entraîne en miroir la « multiplication potentiellement infinie des possibilités d’intervention », dans tous les domaines de la vie individuelle et collective : « en effet, quelle est la situation dont on puisse être assuré qu’elle ne comporte pas de risque, c’est-à-dire aucun aléa, aucun élément incontrôlable ou imprévu ? » (p. 123). On peut alors faire de la prévention de tout ce que l’on veut, et pour cela, mettre en place les dispositifs de surveillance généralisée qui sont nécessaires. Selon moi, l’idée que ces dispositifs étaient mis en place dans notre intérêt a favorisé la diffusion d’une attitude de servitude volontaire à leur égard : la prédominance des contrôles, dépistages et impératifs de gestion dictés par les expertises sécuritaires se nourrit autant de la castration des principes démocratiques fondamentaux de notre société, que de l’idée, devenue imparable, selon laquelle si l’on n’a rien à se reprocher, on n’a pas de raison de refuser d’être surveillé[4]. Cette servitude volontaire à l’égard de la gestion des risques réactualise l’ambivalence de l’idée d’État par rapport à la vie sociale et individuelle. Nombreux sont encore celles et ceux qui disent : certes, l’idée d’État est responsable d’oppressions concrètes, de violences voire de meurtres policiers, de guerres néocoloniales, mais, enfin, l’État est également le garant de la santé publique, des solidarités, de l’éducation, du droit, etc. !
Sans doute, les crises sanitaires et financières qui vont s’ajouter à la crise climatique provoquée par l’inaction et la vénalité des gouvernants prouveront qu’il n’y a plus de confiance à avoir dans l’idée d’État : celui-ci en effet n’est, concrètement, qu’un ensemble d’instruments, d’appareils, de services publics, d’institutions matérielles et imaginaires, qui, en dernière instance, seront uniquement au service des classes dirigeantes tant qu’ils auront une structure pyramidale, élitiste voire « royaliste » et fidèle au « patronat de droit divin »[5]. La forme d’État fondée sur la gestion capitaliste ne peut plus mériter notre confiance : « Les idéologies modernes de la prévention sont surplombées par une grande rêverie technocratique, rationalisatrice, du contrôle absolu de l’accident conçu comme irruption de l’imprévu. Au nom du mythe de l’éradication absolue du risque, elles construisent elles-mêmes une foule de risques nouveaux qui sont autant de cibles pour les interventions préventives (…) Ainsi, une grande utopie hygiéniste joue-t-elle sur les registres alternés de la peur et de la sécurité pour imposer un délire de rationalité dévoyée, le règne absolu de la raison calculatrice et le pouvoir non moins absolu de ses agents, planificateurs et technocrates, administrateurs du bonheur d’une vie à laquelle rien n’arrive » (p. 123-124). La gestion des risques se fonde sur les mêmes tendances rationnelles que le calcul marchand. L’extension des pratiques de surveillance au service de la sécurité de l’ordre bourgeois entraîne des conséquences à différents niveaux.
3. De la discipline à l’efficience et vice-versa
La première conséquence est une « dissociation du diagnostic et de la prise en charge et transformation de l’activité soignante en activité d’expertise ». Cela signifie que l’évaluation médicale devient de plus en plus une « expertise » visant à « marquer un individu, à lui constituer un profil qui va le placer sur une filière ». Comme le suggèrent selon R. Castel les commissions départementales sur le handicap, les individus sont distribués sur des circuits qui ne sont pas nécessairement soignants, mais relèvent en grande partie d’une « assignation administrative ». Les gens sont donc « vus » davantage que « suivis » par des spécialistes, ce qui change toute la logique de la prise en charge : « on est dans une perspective de gestion autonomisée des populations sur la base de profils différentiels qui sont tracés pour elles à partir de diagnostics médico-psychologiques fonctionnant comme pures expertises » (p. 124). Les logiques de gestion des risques attachés à une population deviennent surdéterminantes, et produisent l’extension des logiques gestionnaires jusque dans les populations elles-mêmes et les modes de prises en charge : dans les grandes institutions, on ne gère non plus seulement les risques, mais aussi, de fait, les gens. Les pratiques et logiques gestionnaires deviennent surplombantes, autonomes.
La deuxième conséquence est la nouvelle « subordination complète des techniciens aux administrateurs », comme on le devine en observant l’autonomisation des logiques gestionnaires, mais comme on l’observe aussi actuellement avec la prolétarisation, voire l’ouvriérisation des soignant.e.s et travailleur.euse.s sociaux[6]. Certes, observe R. Castel, historiquement, les champs du soin, du social, se sont largement construits autour de la tension entre les logiques de travail portées par les « administrateurs » et les logiques de travail portées par ceux que j’appellerais les ouvriers et ouvrières de l’humain (p. 124). En effet, les processus d’institutionnalisation de différentes initiatives, dans le soin, la santé mentale, le social, la solidarité, etc., présentent des tendances communes malgré différents contextes : d’abord, des « praticiens » innovent dans leur champ pour répondre aux évolutions des besoins du terrain, puis ils doivent faire appel à la puissance publique pour qu’elle les aide à structurer leurs innovations et leur offre une « officialisation » après différentes tractations et négociations ; enfin, ils constatent que l’action de la puissance publique implique une subordination de leurs aspirations et logiques de travail aux intérêts du « pouvoir administrativo-politique », et finalement « crient à la trahison, à la dénaturation de leurs intentions humanistes au profit d’exigences purement bureaucratiques, voire répressives » (p. 125). Parlant plus spécifiquement du travail social, le sociologue Michel Autès repère les mêmes grandes tendances du processus d’institutionnalisation : « Toutes ces professions suivent quasiment la même logique de constitution. D’abord, elles naissent de l’initiative privée, le plus souvent avec un caractère militant, incarné dans une implication bénévole. Puis elles sont amenées à développer des services qui nécessitent le concours financier de la puissance publique, qui cherche à son tour à encadrer, à codifier, à définir les règles »[7].
Mais cette représentation schématique de la « relation praticiens-administrateurs envisagée dans sa dimension politique » est bousculée par la gestionnarisation des logiques de travail, et par la prise de pouvoir des administrateurs : « L’administration prend une autonomie à peu près complète parce qu’elle a la maîtrise quasi absolue de la technologie nouvelle. L’opérateur de terrain apparaît alors comme un simple auxiliaire du gestionnaire qu’il alimente en informations sur la base de cette activité de diagnostic-expertise dont je parlais précédemment. Ces informations sont alors stockées, traitées et distribuées sur des circuits complètement déconnectés de la pratique professionnelle, en particulier par l’intermédiaire de l’informatique. Il y a là source d’un déséquilibre fondamental. Le rapport qui liait directement le fait de posséder un savoir sur un sujet et la possibilité d’intervenir sur lui (que ce fût un bien ou un mal) s’est brisé. Les praticiens sont complètement subordonnés aux objectifs d’une politique gestionnaire. Ils ne contrôlent plus l’usage des données qu’ils produisent. C’est le gestionnaire qui est le véritable «décideur». C’est lui qui possède l’ensemble des cartes et qui peut mener le jeu » (p. 125-126).
La troisième grande conséquence esquissée par R. Castel n’est pas moins actuelle et importante, puisque les orientations décrites tout au long de l’article semblaient à l’époque, pour le jeune sociologue, inaugurer « de nouvelles stratégies de gestion de populations propres aux sociétés dites « néo-libérales » ». Ces stratégies ne passeraient plus uniquement par la répression ou l’assistance, mais viseraient à opérer une gestion différenciée des individus – des « parcours » – selon les hypothèses ou facteurs de productivité qui leurs seraient attachés : « on constate le développement de modes différentiels de traitement des populations, qui visent à rentabiliser au maximum ce qui est rentabilisable, et à marginaliser ce qui ne l’est pas. Plutôt que d’arracher du corps social les éléments indésirables (ségrégation) ou de les réintégrer plus ou moins de force à coup d’interventions correctrices ou thérapeutiques (assistance), la tendance qui se fait jour consiste à assigner des destins sociaux différents aux individus en fonction de leur capacité à assumer les exigences de la compétitivité et de la rentabilité » (p. 126).
À l’époque, R. Castel était témoin du développement du chômage de masse et de l’entrée dans une période de crise du mode de production hérité des Trente Glorieuses suite aux chocs pétroliers des années 1970. Anticipant les thèmes de réflexion qui seront les siens quelques années plus tard, il pointe déjà dans cet article de 1983 un risque de dualisation de l’ensemble social, de fracture entre des « secteurs hypercompétitifs » d’un côté, et, de l’autre, des zones marginalisées, servant de « refuge » ou de « dépotoir » à celles et ceux qui sont rejetés par la concurrence marchande comme surnuméraires. Quelques années plus tard, on parlera de « société en sablier », dualisée, et Saskia Sassen montrera comment, concrètement, se manifeste cette dualisation à l’intérieur des « villes globales », qui se présentent comme des espaces a priori paradoxaux mettant en contact une très forte concentration de richesses, de pouvoirs et d’infrastructures, avec une « économie de la survie » et des bataillons de travailleuses et travailleurs subalternes, précarisés, dans des zones généralement périphériques[8].
Si la constitution de tels espaces de concentration productive est sous-tendue par de véritables « efforts de programmation » des équipements et infrastructures, observe Castel : « il faut se demander si, désormais, il ne serait pas technologiquement possible de programmer les populations elles-mêmes (…) On peut objectiver n’importe quel type de différence et constituer sur ces bases des profils différentiels de populations. C’est techniquement possible grâce en particulier à l’informatique. Le reste, c’est-à-dire le fait d’assigner sur ces bases un destin spécial à certaines catégories ainsi définies est affaire de volonté politique » (p. 126). On peut imaginer que c’est le système scolaire qui opère les premiers tris, en permettant « d’orienter et d’assigner » les individus selon les besoins de l’économie, certains se retrouvant – ou héritant – de parcours de promotion économique, sociale, culturelle, liés à leur productivité programmée, tandis qu’aux bas échelons de la pyramide sociale, certaines personnes dépistées improductives – ou du moins, pas assez compétitives – seraient inscrits dans des carrières d’assistés sociaux ou sanitaires pour des durées plus ou moins longues. C’est en ce sens, semble-t-il, que de nombreux observateurs ont pointé l’ambivalence des politiques d’assistance, qui apprennent aux bénéficiaires à se contenter de modestes aides sociales, à condition qu’ils fassent preuve d’une servitude volontaire de plus en plus forte à l’égard des contrôles, et que, surtout, les conditions sociales, économiques et politiques qui produisent ces situations d’« exclusion » ne soient jamais fondamentalement remises en cause[9].
Ainsi, « le profilage de flux de population à partir d’une combinatoire de caractéristiques » produit une nouvelle image de notre ensemble social : « celle d’un espace homogénéisé fait de circuits dessinés à l’avance et que les individus sont invités ou incités à emprunter selon leurs capacités ou leurs incapacités ». On voit que les logiques de gestion des risques sont un des principaux symptômes, dans les secteurs du social et de la santé, d’une rationalité calculatrice et instrumentale qui a toujours été liée aux pouvoirs économiques et politiques – autant que l’idée de hiérarchie – mais qui semble renouvelée et réactualisée par les techniques et technologies modernes de surveillance, de gestion, et de traitement de l’information : « Projection d’un ordre plutôt que son imposition après-coup, cette pensée a moins pour obsession la discipline que l’efficience. Son maître d’œuvre principal n’est plus le praticien de terrain qui intervient pour colmater les brèches ou empêcher qu’elles ne s’ouvrent, mais l’administrateur qui planifie les orientations et y fait correspondre les profils humains » (p. 127). Les nouvelles technologies de l’information et de la communication, telles que présentées et utilisées par le « pouvoir administrativo-politique » et économique, font évoluer les normes et les pratiques au moins aussi vite que les idéologies de gouvernement.
La réactualisation, depuis les trois dernières décennies du XXème siècle au moins, des dimensions instrumentales, gestionnaires et calculatrices de l’exercice du pouvoir étatique suggère à quel point les champs sanitaires et sociaux, et tous les champs présentés comme incarnant l’intérêt général ou le service public, sont en fait à la merci des appareils d’État, qui les manient et les ordonnent comme des composantes des politiques publiques, de leurs propres interventions : comme des instruments. Cette rationalité instrumentale, qui paraît consubstantielle au pouvoir des appareils d’État modernes, a rencontré à partir des années 1980 une forme spécifique, une teneur particulière d’intervention publique, fondée sur une croyance nouvelle arrivée aux portes du pouvoir : la capacité à l’autorégulation générale de l’économie donc de la société, par les logiques marchandes concurrentielles elles-mêmes. La nouvelle forme de l’instrumentalisation politique des secteurs sociaux et de sanitaires à travers les technologies de gestion des risques et de surveillance comme maintiens de l’ordre social s’est doublée d’une libéralisation de l’économie et d’une marchandisation des cadres de travail. La conjonction et l’approfondissement de ces phénomènes dus aux progrès des technologies gestionnaires et marchandes sont les principaux phénomènes responsables du processus global d’industrialisation du social, de la santé et de nombreux autres champs. Ils nous poussent chaque jour à davantage de méfiance à l’égard des appareils d’État, à plus forte raison en période de crise sanitaire, et cela tant que ces appareils censés servir l’intérêt général et le service public seront gérés uniquement par des experts et administrateurs omnipotents, sans aucune place pour l’expression des intérêts réels des premières personnes concernées elles-mêmes : les professionnel.le.s de terrain et personnes bénéficiaires.
Avril 2020
[2] Voir le « dossier Covid-19 » du Monde Diplomatique n°793 (avril 2020), pp. 17-23, ou encore Erwan Manac’h, le 08 avril 2020, « Trente ans de « management public » en accusation », dans Politis n°1598, en ligne.
[3] Jeanine Verdès-Leroux, 1978, Le travail social, Paris, Éditions de Minuit, p. 184.
[4] Ce à quoi Edward Snowden a répondu dans un documentaire sorti en 2014 : « Lorsque vous dites « le droit à la vie privée ne me préoccupe pas, parce que je n’ai rien à cacher », cela ne fait aucune différence avec le fait de dire « Je me moque du droit à la liberté d’expression parce que je n’ai rien à dire », ou « de la liberté de la presse parce que je n’ai rien à écrire ». » (Citizenfour)
[5] Saül Karsz, 1992, « Questions sur le social d’entreprise », dans Collectif, Déconstruire le social. Séminaire I dirigé par Saül Karsz, Paris, Éditions L’Harmattan, Cahiers de pratiques sociales, p. 77.
[6] Jonathan Louli, 2018, « Le travail social en voie d’industrialisation ? », in Le Sociographe, n°64, pp. 95-103, en ligne.
[7] Michel Autès, 1999, Les paradoxes du travail social, Paris, Dunod, p. 59.
[8] Saskia Sassen, 1994, « La ville globale. Éléments pour une lecture de Paris », Le Débat, vol. 80, no. 3, p. 137-153.
[9] Nicolas Duvoux, 2013, « Comment l’assistance chasse l’État social », Idées économiques et sociales, n° 171, p. 10-17, en ligne.
